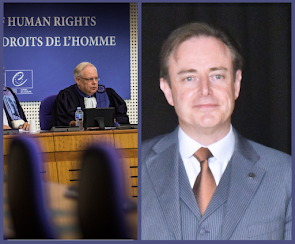Enlèvement, torture et meurtre d'un haut lama tibétain - Appel Urgent Mai 2025
Le 29 mars on annonce la mort à Saïgon du lama Hungkar Dorje Rinpoché, des suites d’une maladie. Cependant ses partisans réfutent la version des autorités et racontent qu’il a été arrêté le 25 mars dans sa chambre d’hôtel lors d’une opération coordonnée de la police locale et d’agents secrets chinois. Retenu 48 heures avant son transfert au bureau local de la Sécurité publique, il y décède le même jour. L’ONG International Campaign for Tibet et des exilés tibétains confirment la funeste arrestation. Le 1er avril, le gouvernement chinois informe le monastère Lung Ngon du décès du religieux, souffrant. Cependant, ses partisans affirment que le Lama a été torturé.
Le 5 avril, cinq moines de Lung Ngon réclament la dépouille de Hungkar Rinpoché en vue de funérailles au Tibet. Ils sont sommés de signer son certificat de décès sans voir le corps, refusent, et seulement trois jours après apercevront brièvement le visage du défunt à l’hôpital, gisant sous un drap. C’est que le 14 avril Xi Jinping se rend au Vietnam pour « renforcer les liens entre les deux pays en guerre commerciale avec les États-Unis». Afin de garantir la discrétion de la crémation, on déplace la dépouille vers un cimetière voisin le 18 avril. On saisit également les téléphones de ceux qui sont présents. 70 fonctionnaires chinois et vietnamiens sont déployés et toute forme d’enregistrement est interdite. Le 20 avril Hungkar Rinpoché est incinéré de nuit. Le certificat de décès mentionne sa mort à l’hôpital le 28 mars. Cependant, selon International Campaign for Tibet, il a été enlevé et soumis à un interrogatoire qui aurait entraîné sa mort. En réaction, des manifestations éclatent à Dharamshala (Inde), siège du gouvernement tibétain en exil.
Mort d'une figure centrale de la préservation de la culture tibétaine
Hungkar Dorje Rinpoché, ou Trulku Hungkar Dorje, haut lama tibétain de 56 ans, s’intéressa aux enseignements bouddhistes. À 22 ans il part en Inde approfondir ses connaissances dans un monastère. Entre 1995 et 19997, il poursuit des études supérieures aux États-Unis. Maître spirituel vénéré par des milliers de Tibétains, il est reconnu pour sa profonde compréhension des doctrines bouddhistes et sa guidance sur le chemin de l’éveil. L’adjectif Rinpoché [ précieux] lui confère le statut d’un grand maître spirituel du passé, réincarné. Devenu abbé du monastère Lung Ngon, il se consacre à l’éducation et à la préservation de la culture tibétaine. Il fonde des écoles primaires, des collèges, ainsi que des monastères et des académies, dont le lycée professionnel national Hungkar Dorje où l’apprentissage est gratuit. A son actif, plus de vingt livres sur les langue, traditions et pratiques culturelles tibétaines. Philanthrope, il apporte un soutien matériel à des milliers de Tibétains. Son engagement pour la transmission du savoir religieux en fait une figure centrale de la préservation de la culture tibétaine. D’abord reconnu par les autorités chinoises, il est désavoué après qu’il ait dit son opposition au faux Panchen- lama - Gyaltsen Norbu rejeté par le Dalaï-lama et qu’il accueillit à contrecœur dans son monastère. Les autorités lui reprochent alors un manque d’«accommodement» et des prières de longue vie au Dalaï-lama. Tant et si bien que la surveillance étroite de son monastère débouche sur son exil, puis sur une période de clandestinité au Vietnam.
Persécution de toute opposition au pouvoir chinois
La répression s’accentue à l’encontre des vecteurs de la culture tibétaine. Depuis 1950, les droits des Tibétains ne cessent d’être foulés aux pieds. Leurs aspirations sont étouffées par les restrictions religieuses et les destructions de monastères. Sitôt l’imposition de la loi martiale en 1989, le Parti communiste chinois, qui redoute le mouvement international en faveur du Tibet, intensifie ses actions contre les intérêts tibétains. Au début des années 2000, le PCC contraint les fonctionnaires tibétains à inscrire leurs enfants dans des écoles chinoises. Après l’insurrection de 2008, le gouvernement s’attache à distendre les liens entre les Tibétains en exil et leur pays. Il alourdit la répression transnationale vis-à-vis de la diaspora et définit « cinq poisons » : Tibétains, Ouïghours, Taïwanais, dissidents du Falun Gong ou de Mongolie intérieure. Misant sur la centralisation et sur une politique étrangère agressive, Xi Jinping persécute toute opposition. Les questions touchant les minorités ethniques basculent dans la catégorie sécuritaire. Pour bâillonner l’opposition, les réseaux de solidarité sont démantelés. Des régimes autocratiques (Birmanie, Iran, Venezuela) emboîtent le pas à la RPC. En 2022, le gouvernement chinois rapatrie deux dissidents réfugiés au Vietnam où ils avaient été expulsés. Fin 2024, Chen Wenqing, responsable de la sécurité d’État en RPC, appelle à une répression accrue du séparatisme au Tibet. Il annonce un durcissement de la politique culturelle et éducative dans la région.
Source : ACAT-France